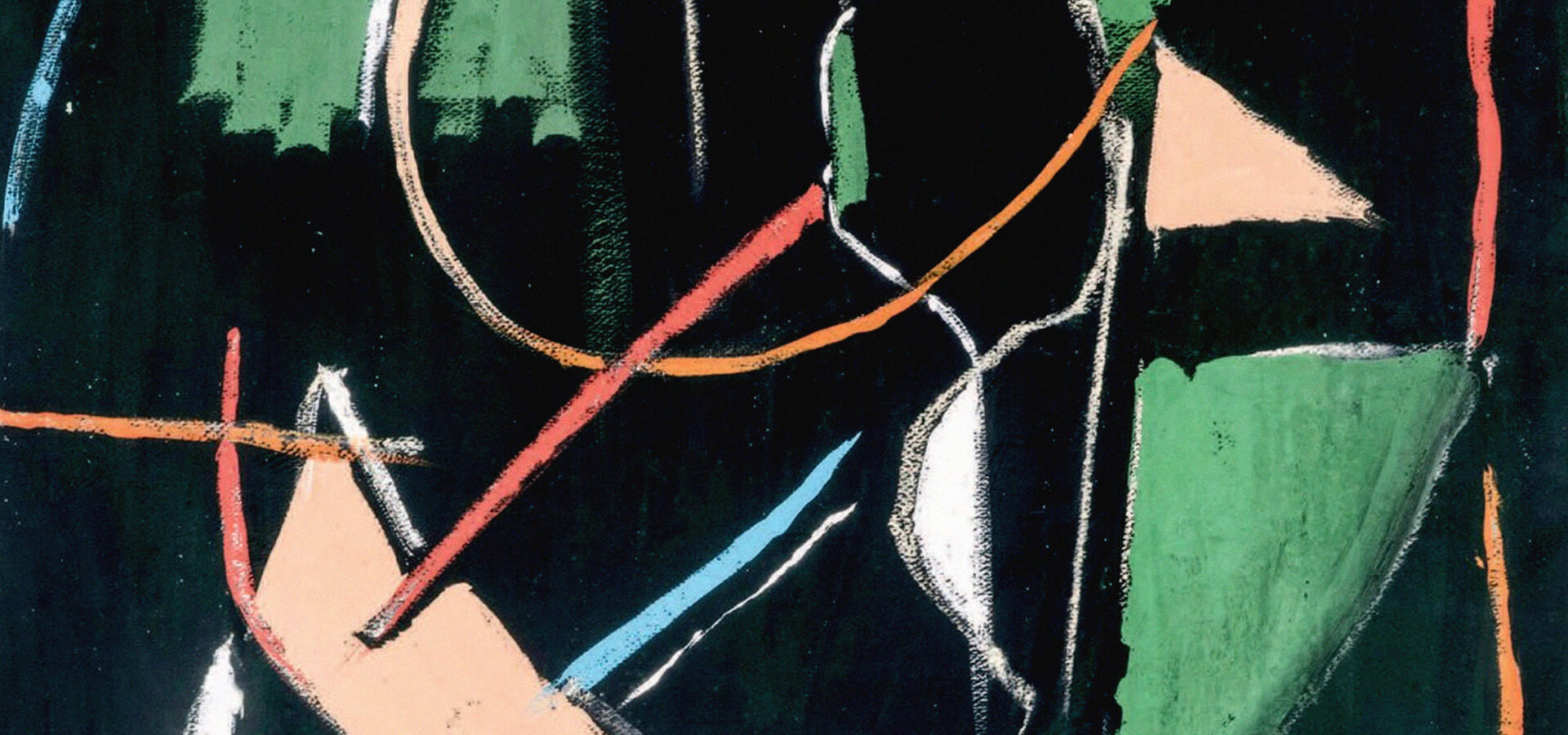Entretien inédit pour le site de Ballast
Réconcilier deux frères ennemis ? Fondre le meilleur de deux traditions qui, trop souvent, se sont déchirées ? C’est ce que tente, après d’autres, le livre Affinités révolutionnaires — Nos étoiles rouges et noires, paru à l’automne 2014 aux éditions Mille et une nuits. Deux plumes — Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, et Michael Löwy, sociologue et philosophe franco-brésilien — y appellent au marxisme libertaire pour contrer la faillite de la gauche gouvernementale et la poussée du nationalisme. Nous en discutons avec le second.

Il y a deux sortes de « politique » en Europe. Non seulement différentes, mais antagoniques, contradictoires, irréconciliables. La première est la politique officielle, institutionnelle, représentée par les gouvernements, qu’ils soient de centre-droit ou de centre-gauche, ou encore, de plus en plus, d’extrême centre : les partis majoritaires au Parlement, et leurs diverses combines et manigances ; les différentes bureaucraties administratives, judiciaires, religieuses ou sportives. Que ces gouvernements et partis soient « honnêtes » (?) ou corrompus, « progressistes » ou conservateurs, intelligents ou stupides, partisans de la « croissance » ou de l’« austérité », social-libéraux ou néolibéraux, « normaux » ou agités, prétendument « socialistes » ou soi-disant « populaires », modernisateurs ou traditionalistes, ils ne représentent que des variantes de la même politique, celle du système, celle du capital financier, celle du capitalisme globalisé, celle qui perpétue et aggrave les inégalités, celle qui perpétue et accélère la destruction de l’environnement, celle qui a conduit à la présente crise économique et qui conduira, dans quelques décennies, à une catastrophe écologique. C’est la politique du statu quo, du business as usual, de la « gouvernance » du système, du maintien de l’ordre, de la police (au sens donné à ce terme par Jacques Rancière), de la gestion des affaires du capital, de la neutralisation et/ou répression des conflits, de la « compétitivité » à mort, des coupes sombres dans les salaires et les retraites, des privatisations à tour de bras, des cadeaux fiscaux aux riches, du démantèlement des services publics, de la course aux armements.
« Sans indignation et sans utopies, sans révolte, sans images d’un monde autre, d’une nouvelle société, plus juste et plus solidaire, la politique devient mesquine, vide de sens, creuse. »
Cette politique-là règne, elle gouverne partout, elle est aux commandes, elle exerce le pouvoir d’État à l’échelle nationale et continentale. Elle continuera donc encore longtemps à exercer sa domination sur les peuples de l’Europe, à moins que… À moins qu’une autre conception de la politique s’impose — dont le point de départ est l’indignation ! Célébrant la dignité de l’indignation et de l’inconditionnel refus de l’injustice, Daniel Bensaïd écrivait : « Le courant brûlant de l’indignation n’est pas soluble dans les eaux tièdes de la résignation consensuelle. […] L’indignation est un commencement. Une manière de se lever et de se mettre en route. On s’indigne, on s’insurge, et puis on voit. » Sans indignation, rien de grand ni de profond ne s’est fait dans l’histoire humaine. Si le petit pamphlet de Stéphane Hessel, Indignez-vous !, a eu autant de succès, c’est parce qu’il correspondait au sentiment profond, immédiat, de millions de jeunes, d’exclus et d’opprimés de par le monde. L’autre ingrédient de la politique au sens noble — c’est-à-dire, plébéien — du terme, c’est l’utopie. Sans indignation et sans utopies, sans révolte et sans ce qu’Ernst Bloch appelait « paysages de désir », sans images d’un monde autre, d’une nouvelle société, plus juste et plus solidaire, la politique devient mesquine, vide de sens, creuse. La guerre entre ces deux formes du politique ne fait que commencer.
Vous expliquez que la gauche est « désarmée » face à la montée du nationalisme, partout en Europe et spécifiquement en France. Comment cela a‑t-il pu se produire ?
La première raison est celle dont il est question ci-dessus : dans plusieurs pays, notamment en France, la gauche s’est identifiée avec le « système », avec les brutales politiques néolibérales dites d’« austerité » (iniquité serait un terme plus approprié), avec la soumission aux intérêts du capital financier. C’est le cas en France avec le gouvernement « de gauche » de François Hollande, soutenu, dans un premier moment, par le PCF. Pour une partie de la population, « la gauche », dans toutes ses formes, est responsable du chômage, des fermetures d’usines, de la dégradation des services publics. Cela a fait le lit de l’extrême droite nationaliste, de matrice fasciste, raciste et xénophobe, dont le Front national est la principale force. En outre, la gauche, même radicale — c’est-à-dire anti-néolibérale —, a longtemps sous-estimé le danger du nationalisme réactionnaire et raciste. Le détournement des voix du FN par le candidat de droite Sarkozy, il y a six années, à créé l’illusion que l’extrême droite était en déclin. D’où le retard, qui dure encore, à organiser une riposte antifasciste unitaire et massive. Cela dit, le seul espoir d’opposer à cette vague brune qui menace de submerger la France et l’Europe une alternative crédible, c’est le développement, dans l’unité, des forces de la gauche radicale et anticapitaliste, libre de toute compromission avec les gouvernements de type social-libéral.

Extrait d'une toile d'André Lanskoy
Si vos premières publications attestent de votre ancrage communiste (un premier livre sur Guevara en 1970, un second sur Marx la même année), votre dernier ouvrage, Affinités révolutionnaires, met en avant la dimension libertaire de votre pensée. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la tradition anarchiste ?
J’ai toujours eu de la sympathie pour les mouvements anarchistes, notamment la CNT-FAI espagnole de 1936. Pendant ma jeunesse au Brésil, je suis devenu ami d’Edgard Leuenroth, un vieil militant anarcho-syndicaliste, dont l’archive était une source extraordinaire de connaissance du mouvement ouvrier brésilien. Leuenroth aimait me raconter des histoires sur la grève générale de 1917 à São Paulo, dirigée par les anarcho-syndicalistes, qui avait paralysé la ville pendant plusieurs semaines. Vers 1967, bien avant mon livre sur Che Guevara, j’avais écrit un article sur « Kafka et l’anarchisme ». Mais c’est surtout au cours des années 1980 que j’ai commencé à travailler de façon intensive sur la culture anarchiste, au cours de ma recherche sur le « judaïsme libertaire » en Europe centrale, où des penseurs comme Gustav Landauer et Walter Benjamin occupent une place essentielle. Je suis revenu plus récemment sur la dimension libertaire de Kafka dans mon livre Franz Kafka, rêveur insoumis. Enfin, grâce à la rencontre avec Olivier Besancenot, qui a toujours eu un grand intérêt pour la tradition anarcho-syndicaliste, est apparue l’opportunité d’une réflexion plus générale sur les convergences possibles entre marxisme et anarchisme, d’un point de vue « marxiste libertaire ».
Dans cet essai, vous insistez sur le caractère despotique du régime soviétique et reconnaissez même la responsabilité de Trotsky dans le massacre des marins de Kronstadt. Cet autoritarisme, antérieur à Staline, n’était-il pas inhérent aux conceptions politiques et philosophiques de Lénine et des bolcheviks ?
« Pour une partie de la population,
la gaucheest responsable du chômage, des fermetures d’usines, de la dégradation des services publics. »
C’est une question complexe, qui ne peut pas être répondue en quelques lignes… Des tendances autoritaires — nous ne parlons pas de « despotisme » avant la victoire de Staline — sont apparues très tôt dans le régime issu de la Révolution d’Octobre. Dès 1918, Rosa Luxemburg avait mis en question les dérives anti-démocratiques des bolcheviks, tout en leur apportant un soutien critique — comme l’ont fait d’ailleurs, jusqu’en 1921, beaucoup d’anarchistes. Ces dérives s’expliquent, dans une certaine mesure, par leur avant-gardisme, mais beaucoup plus par les circonstances terribles de la guerre civile. Ces tendances autoritaires ont abouti au tragique conflit de Kronstadt, dont la principale responsabilité, à notre avis, incombe aux bolcheviks, par leur refus de la proposition de médiation avancée par Emma Goldman et Alexander Berkman. Si les erreurs de Lénine, Trotsky et leurs camarades ont facilité le Thermidor bureaucratique de Staline, il n’existe pas moins, à notre avis, une différence profonde entre bolchevisme et stalinisme, entre l’autoritarisme révolutionnaire et le despotisme de la contre-révolution bureaucratique.
Dans les pas de Daniel Guérin, vous appelez à régénérer le marxisme par un bain libertaire. En quoi le terme « marxisme » est-il toujours opérant à vos yeux ?
Nous nous réclamons du communisme, comme concept révolutionnaire qui inclut différentes traditions : marxisme, anarchisme, blanquisme, etc. Le marxisme, plus qu’une « personne », renvoie à un corpus théorique et pratique — pluriel et divers — qui commence avec Marx et Engels, mais se poursuit avec Lénine, Rosa Luxemburg, Trotsky, Gramsci, Lukács, Walter Benjamin, l’École de Francfort, Herbert Marcuse, André Breton, Guy Debord, Jean-Paul Sartre, José Carlos Mariategui, CLR James, EP Thompson, Amílcar Cabral, Ernesto Che Guevara et bien d’autres. Beaucoup de penseurs anarchistes, de Bakounine à Daniel Guérin, ont reconnu la puissance théorique de l’œuvre de Marx et des marxistes. Cette puissance est toujours opérative, à condition que le marxisme ne soit pas figé en un système de dogmes, qui transforme les écrits de Marx, ou de Lénine, ou de Trotsky en Écritures saintes ayant réponse à tout. Le marxisme ne peut exister que comme une pensée dialectique, en mouvement, en transformation permanente, capable d’intégrer les apports de mouvements sociaux comme l’écologie, le féminisme, l’indigénisme. Nous pensons, Olivier Besancenot et moi, qu’une des façons de renouveler la théorie et la pratique marxistes est d’apprendre avec les réflexions et les expériences libertaires.
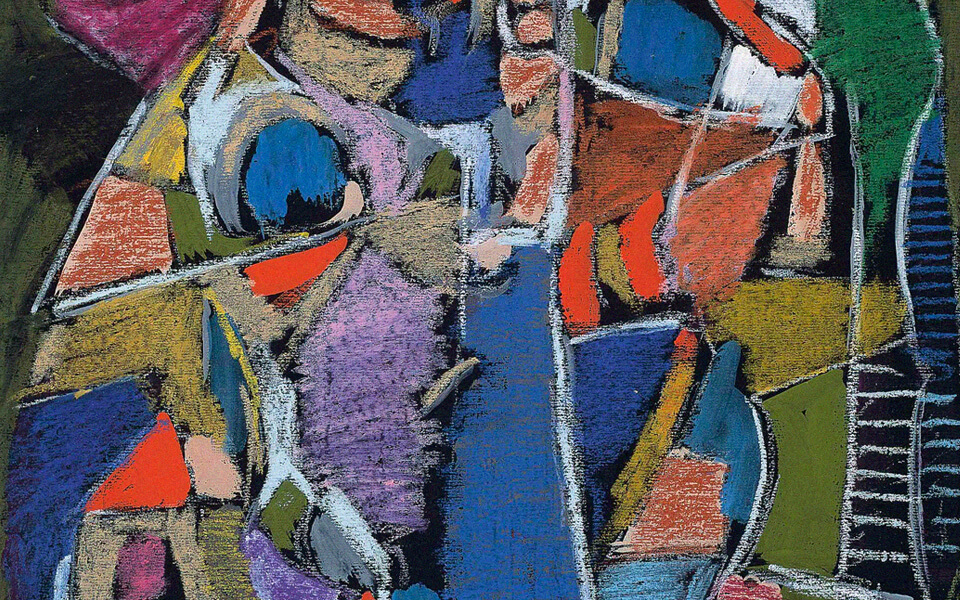
Extrait d'une toile d'André Lanskoy
Vous reprochez aux communistes le peu de cas qu’ils font de l’individualité et aux anarchistes leur mépris improductif pour le collectif : des mouvements sont-ils parvenus à articuler ces deux pôles ?
Je ne vais pas faire une liste, mais nombreux sont les mouvements sociaux et politiques actuels, depuis les zapatistes du Chiapas jusqu’aux Indignés européens, ainsi que des organisations se réclamant du marxisme ou de l’anarchisme, qui tentent, avec plus ou moins de succès, d’associer combat collectif et singularité individuelle…
La question du pouvoir — ne jamais y toucher ou s’en emparer — est au cœur des dissensions entre drapeaux rouges et noirs : comment résolvez-vous cette tension ?
« La gauche sans le peuple n’est rien, mais le peuple a besoin des organisations politiques et des mouvements sociaux de la gauche anti-systémique. »
L’argument anarchiste contre le pouvoir étatique est tout à fait légitime. Mais cela ne veut pas dire qu’on peut se passer de toute forme de pouvoir. La Commune de Paris de 1871 — référence partagée par marxistes et anarchistes — était une nouvelle forme de pouvoir révolutionnaire, non-étatique. Les milices anarchistes de la CNT exerçaient une forme de pouvoir, en Catalogne et Aragon. Et les communautés zapatistes, dans les régions « libérées » du Chiapas, exercent une forme de pouvoir autogérée. Il ne s’agit donc pas de s’« emparer » du pouvoir étatique, ni de nier la nécessité d’une forme de pouvoir, mais de penser à des alternatives démocratiques, fédératives, autogérées et post-étatiques de pouvoir.
Commentant votre ouvrage Che Guevara, une braise qui brûle encore, le philosophe décroissant Jean-Claude Michéa estimait que sa transformation « en icône définitive de la Révolution », mise en place à dessein, cachait le socialisme réellement démocratique et populaire — il songeait à celui d’un Voline ou d’un Durruti. Quel serait l’apport spécifique de Guevara au socialisme du XXIe siècle ?
Nous refusons de choisir entre Guevara et Durruti : chacun d’entre eux représente une expérience révolutionnaire profondément authentique, avec ses problèmes, ses limites et ses contradictions. Il n’y a pas d’« icônes définitives » de la Révolution, mais des penseurs et des combattants qui nous semblent importants pour leurs idées et leurs pratiques. L’apport spécifique de Guevara à un communisme du XXe siècle c’est : a) son internationalisme conséquent, qui a fait d’un médecin argentin un dirigeant de la Révolution Cubaine, ensuite un combattant pour la libération du Congo et finalement un révolutionnaire fusillé en Bolivie ; b) son opposition intransigeante et irréductible à l’impérialisme, au colonialisme et au système capitaliste lui-même, en refusant les compromis et les alliances de classes avec des secteurs de la bourgeoisie ; c) sa recherche d’une voie socialiste alternative au modèle soviétique et ses impasses. Si dans un premier moment de son évolution politique, Guevara nourrit des illusions sur l’Union soviétique, il va assez vite développer des conceptions critiques. Celles-ci concernent la répression de toute dissidence ou critique dans les pays de l’Est, ainsi que l’utilisation, sur le terrain économique, de critères mercantiles. Dans ses derniers écrits, comme la critique du Manuel d’économie politique soviétique — gardées pendant 45 années dans un tiroir par les responsables cubains —, il affirme clairement que ce n’est pas à un Bureau de technocrates, mais au peuple lui-même de décider les priorités économiques de la planification.
Vous êtes proche d’Olivier Besancenot et, sans doute, du NPA : que pensez-vous de l’appel de Jean-Luc Mélenchon à fédérer le peuple sur une base plus large en mettant de côté le terme « gauche », puisque, dit-il, « le système n’a pas peur de la gauche, car il la digère toujours ; le système a peur du peuple » ?
Avec tout le respect que j’ai pour Jean-Luc Mélenchon, qui joue un rôle important par sa dénonciation impitoyable des capitulations du gouvernement prétendument de « gauche » de Hollande et son comparse Valls, je pense qu’il s’agit d’une fausse alternative. Le système n’a pas peur d’une pseudo-gauche social-libérale, qui sert avec zèle les intérêts du capital financier, mais il a peur d’une gauche radicale opposée au néolibéralisme et au capitalisme. Le rôle d’une telle gauche — qui inclut, en France, le Front de Gauche, le NPA, Lutte ouvrière, Alternative libertaire, la Fédération anarchiste, la CNT, et plusieurs autres — serait de contribuer au processus de prise de conscience et d’auto-organisation du peuple — et notamment des travailleurs (hommes et femmes), des chômeurs, des jeunes — dans la lutte pour renverser le système. La gauche sans le peuple n’est rien, mais le peuple a besoin des organisations politiques et des mouvements sociaux de la gauche anti-systémique.

Extrait d'une toile d'André Lanskoy
Dans un livre plus ancien, Révolte et Mélancolie, vous avez réhabilité le romantisme — voire, même, une certaine forme de nostalgie — dans une perspective anticapitaliste. En quoi le passé peut-il être une force d’appui émancipatrice et non un frein, une énergie « réactionnaire » ?
Pour comprendre qu’est que le romantisme, il me semble utile de revenir à un passage peu connu de Marx dans les Grundrisse : « À des stades antérieurs de développement, l’individu singulier apparaît plus complet […]. Il est aussi ridicule d’avoir la nostalgie de cette plénitude originelle que de croire qu’il faille en rester à cette totale vacuité. Le point de vue bourgeois n’a jamais dépassé l’opposition à cette vue romantique, et c’est pourquoi c’est cette dernière qui constitue légitimement le contraire des vues bourgeoises et les accompagnera jusqu’à leur dernier souffle1 ». Le passage de Marx suggère trois idées qui nous semblent essentielles pour comprendre le romantisme : 1) Le romantisme n’est pas une école littéraire mais un point de vue (Ansicht), une vision des choses — une vision du monde, dirions-nous. En tant que Weltanschauung, le romantisme traverse tous les domaines de la culture : la philosophie, la religion, le droit, l’historiographie et, bien entendu, la politique. 2) Cette Ansicht, cette vision du monde s’opposent au point de vue bourgeois, au nom du passé, au nom d’une « plénitude originaire », antérieure à la civilisation bourgeoise. 3) Cette critique des vues bourgeoises et de la « totale vacuité » de la société bourgeoise a une certaine légitimité, même si l’aspiration d’un retour au passé est « ridicule ». 4) Le romantisme n’est pas fini en 1830, ni en 1848 : il accompagnera, comme une ombre portée, la civilisation bourgeoise, tant qu’elle existera (« jusqu’à son dernier souffle »).
« Le romantisme proteste aussi contre la mécanisation, la rationalisation abstraite, la réification, la dissolution des liens communautaires et la quantification des rapports sociaux. »
Dans Révolte et Mélancolie, Le romantisme à contre-courant de la modernité, écrit ensemble avec Robert Sayre, nous considérons que la caractéristique centrale du romantisme comme Weltanschauung est, comme Marx l’avait compris, la révolte, la protestation culturelle contre la civilisation capitaliste moderne au nom de certaines valeurs du passé. Ce que le romantisme refuse dans la société industrielle/bourgeoise moderne, c’est avant tout le désenchantement du monde — une expression du sociologue Max Weber — c’est le déclin ou la disparition de la religion, de la magie, de la poésie, du mythe, c’est l’avènement d’un monde entièrement prosaïque, utilitariste, marchand. Le romantisme proteste aussi contre la mécanisation, la rationalisation abstraite, la réification, la dissolution des liens communautaires et la quantification des rapports sociaux. Cette révolte se fait au nom de valeurs sociales, morales ou culturelles pré-modernes et constitue, à multiples égards, une tentative désespérée de ré-enchantement du monde. On pourrait considérer le célèbre vers de Ludwig Tieck, « Die mondbeglanzte Zaubernacht », « La nuit aux enchantements éclairée par la lune », comme une sorte de résumé du programme romantique…
Si le romantisme s’affirme comme une forme de sensibilité profondément empreinte de nostalgie, il n’échappe pas à la modernité : d’une certaine façon on peut même le considérer comme une forme d’ auto-critique culturelle de la modernité. En tant que vision du monde, le romantisme est né au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle — on peut considérer Jean-Jacques Rousseau comme son premier grand penseur. Contrairement aux idées reçues, l’histoire du romantisme n’est pas terminée au début du XIXe siècle, mais continue tout au long des XIXe et XXe siècles. En fait, il continue, jusqu’à nos jours, à être une des principales structures-de-sensibilité de la culture moderne. Bien évidemment, la nébuleuse culturelle romantique est loin d’être homogène : à partir de cette racine commune anti-bourgeoise on trouve une pluralité de courants, depuis le romantisme conservateur ou réactionnaire qui aspire à la restauration des privilèges et hiérarchies de l’Ancien Régime, jusqu’au romantisme révolutionnaire, qui intègre les conquêtes de 1789 (liberté, démocratie, égalité). Tandis que le premier rêve d’un retour au passé, le deuxième propose un détour par le passé communautaire vers l’avenir utopique : la nostalgie des époques pré-capitalistes est investie dans l’espérance révolutionnaire d’une société libre et égalitaire. Si Rousseau est un des premiers représentants de cette sensibilité romantique révolutionnaire, on la trouvera dans les premiers écrits républicains des romantiques allemands (Schlegel), dans les poèmes de Hölderlin, Shelley et William Blake, dans les œuvres de jeunesse de Coleridge, dans les romans de Victor Hugo, dans l’historiographie de Michelet, dans le socialisme utopique de Pierre Leroux. Le romantisme révolutionnaire n’est pas absent— comme dimension partielle — des écrits de Marx et Engels, et on le retrouve dans les écrits d’autres marxistes ou anarchistes comme William Morris, Gustav Landauer, Ernst Bloch, Henri Lefebvre, Walter Benjamin. Enfin, il marque de son empreinte quelques-uns des principaux mouvements de révolte culturelle du XXe siècle, comme l’expressionnisme, le surréalisme et le situationnisme.

Extrait d'une toile d'André Lanskoy
Pourquoi tenez-vous tant au mot, parfois risible, d’« utopie » ?
Qu’est-ce qu’une utopie ? C’est le sociologue Karl Mannheim qui a donné sa définition « classique » — et encore aujourd’hui la plus pertinente : sont utopiques toutes les représentations, aspirations ou images de désir, qui s’orientent vers la rupture de l’ordre établi et exercent une « fonction subversive ». La démarche de Mannheim s’oppose aux conceptions bien-pensantes et conformistes, qui font de l’utopie un rêve irréaliste ou irréalisable : comment savoir d’avance quelles aspirations seront ou non « réalisables » à l’avenir ? La démocratie n’apparaissait-elle pas comme une utopie « irréaliste » au milieu du XVIIIe siècle ? Tout changement social égalitaire ou libertaire, de l’abolition de l’esclavage à la suppression de la monarchie, a commencé comme une utopie. Le philosophe anarchiste Gustav Landauer a été le premier, dans son livre La Révolution a réhabiliter, au XXe siècle, l’utopie comme vision révolutionnaire. Mais c’est Ernst Bloch, le philosophe marxiste du Principe Espérance, qui a mis l’utopie concrète au centre de sa conception de l’histoire. Pour Bloch, l’utopie est un non-encore-être : elle est « paysage de désir », l’anticipation d’une monde non-encore-devenu mais ardemment désiré. Nos adversaires ont l’habitude de rire de concepts comme « romantisme », « révolution », « utopie ». Quand ils nous prendrons au sérieux, je crains que ce sera, pour eux, trop tard…
- Karl Marx, Manuscrits de 1857–1858, dits « Grundrisse », Éditions Sociales, 2011, p. 121.[↩]