Entretien inédit pour le site de Ballast
« Si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort tous nos semblables qui portent museau et ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, nous n’aurions certainement pas réalisé notre idéal. Pour ma part, j’embrasse aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste », fit savoir Élisée Reclus, communard et géographe. Si l’idée fait son chemin, chaque jour un peu plus, elle n’en demeure pas moins minoritaire — y compris parmi les partisans de l’émancipation. Nous en discutons, dans le détail, avec ceux qui en France font figure de pionniers : Les Cahiers antispécistes — rappelons que le spécisme affirme l’inégale dignité des espèces au profit de l’une d’entre elles, humaine. Plus de deux décennies d’existence et du mouvement au sein de leur rédaction : la revue affiche une pluralité d’auteurs dont les analyses ne convergent pas en tout point (elle « ne doit pas être vue comme le véhicule d’une doctrine unique, arrêtée une fois pour toutes », tiennent-ils à nous préciser. « De ce fait, nous avons parfois eu quelque scrupule à répondre aux questions au nom des Cahiers antispécistes. Les Cahiers, ce n’est personne, ou c’est l’ensemble de ses contributeurs. »). Premier volet.

Le climat est en effet foncièrement différent aujourd’hui de ce qu’il était au début des années 1990. Les questions ayant trait à la libération animale et aux droits des animaux ont percé tardivement en France, par rapport au monde anglo-saxon. Dans les premiers temps, une poignée d’antispécistes n’avaient pas les moyens humains et matériels d’être audibles à grande échelle. Plus fondamentalement encore, le problème était de faire accepter le débat. Le spécisme, le carnisme, étaient à la fois invisibles et omniprésents. Ils n’avaient pas de noms, tout en étant si profondément ancrés dans les normes et croyances communes que, pour beaucoup, il était tout simplement inconcevable de les questionner. Au mieux, on vous regardait, incrédule, avec la tête de celui qui se demande de quelle planète vous débarquez : « Comment, vous ne savez pas que les humains sont omnivores ? » ; « Le sort des rats et des poulets est une question éthique majeure, dites-vous ? Sans blague ? » Ou alors, le ton passait rapidement à l’invective avec des accusations de traîtrise à l’humanité, fanatisme, visées dictatoriales, et autres amabilités.
« Depuis des millénaires, on trouve dans diverses cultures des pensées, philosophies, croyances, qui ne rabaissent pas les animaux. »
Un quart de siècle plus tard, le contraste est en effet extraordinaire. Dans la presse, l’édition, les réseaux sociaux, certains travaux universitaires, la question animale occupe une place croissante. Aymeric Caron est invité sur tous les plateaux pour la sortie de son essai Antispéciste. Les vidéos d’enquêtes en caméra cachée de L214 émeuvent l’opinion et les porte-parole de l’association ne manquent pas une occasion de dire face aux médias que c’est l’existence même des abattoirs qui pose problème, et qu’ils s’inscrivent dans une lutte politique. De l’intérieur du mouvement animaliste, on est frappé par la multiplication des bonnes volontés qui se manifestent, tant pour apporter un soutien à des actions programmées par d’autres que pour développer des initiatives propres, sous des formes riches et diverses. Pour citer un exemple entre mille, le 30 juin 2016, l’association 269 Libération Animale a pu mobiliser des volontaires pour des veillées devant une trentaine d’abattoirs. Le fait que la Coordination rurale ait jugé utile d’envoyer des contre-manifestants est un indice de plus que le monde agricole a perdu la certitude que l’élevage ne serait jamais remis en cause, hormis chez quelques marginaux. Et on ne parle ici que de la France, alors que la montée en puissance du mouvement pour un traitement plus éthique des animaux est sensible au niveau international.
Rétrospectivement, il est assez facile de trouver des explications convaincantes des progrès accomplis en relativement peu d’années. Avouons cependant qu’en la matière, on est un peu comme les économistes qui savent très bien expliquer après coup pourquoi un krach financier était inévitable et comment il a tourné à la crise systémique, mais qui ne savent pas à l’avance prédire son ampleur et le moment de son déclenchement. En tout cas, nous avons conscience qu’il est trop tôt pour crier victoire. Il reste énormément à faire pour consolider et amplifier les avancées obtenues. Nous n’avons pas affaire à une success story fulgurante commencée il y a à peine un demi-siècle. Depuis des millénaires, on trouve dans diverses cultures des pensées, philosophies, croyances, qui ne rabaissent pas les animaux. Selon Norm Phelps, l’idée qu’une même morale vaut pour les humains et les animaux est plus ancienne que l’idée qu’il est légitime de les exploiter et de les tuer, sous réserve de le faire avec une relative douceur. En Occident — pourtant réputé particulièrement enclin à se représenter les humains comme radicalement distincts et infiniment supérieurs aux animaux —, des auteurs plaident pour le végétarisme depuis l’Antiquité (voyez l’ouvrage de Renan Larue, Le Végétarisme et ses ennemis, paru en 2015) ; on a assisté à une montée de la sensibilité à l’égard des bêtes au siècle des Lumières, tandis que le XIXe siècle a vu naître les sociétés végétariennes et se développer les mouvements de protection animale. Parviendrons-nous mieux que nos prédécesseurs à modifier le cours des choses ?

(Par Bill Traylor)
Le changement opéré en quelques décennies est remarquable dans deux domaines. D’une part, le travail d’examen critique du monceau d’arguments ou arguties avancés pour nier, justifier ou tenir pour indifférents les torts causés aux animaux porte ses fruits : ces arguments ne semblent plus autant couler de source pour le public — et les acteurs des industries animales sont acculés à une position défensive. D’autre part, la visibilité des animaux s’est accrue. Le voile se lève sur ce qui se passe réellement derrière les murs des élevages et des abattoirs. Parallèlement, les recherches éthologiques, leur vulgarisation, la circulation des vidéos illustrant l’intelligence, les émotions, la vie relationnelle des animaux, les ont rendus plus proches, plus aptes à inspirer l’intérêt ou la sympathie. Seulement, même s’il est vrai que ces évolutions ont permis des améliorations ponctuelles, globalement, la condition animale se dégrade. La consommation de produits animaux s’étend considérablement avec l’augmentation de la population humaine, et avec la diffusion dans le monde des méthodes de production de masse, qu’il s’agisse de pêche ou d’élevage. Même dans les pays riches où la consommation de viande se stabilise ou décline, le nombre de victimes augmente avec le déplacement de la consommation vers des animaux de petite taille (moins de vaches, plus de poulets). Les espaces où vivent les animaux sauvages se réduisent comme peau de chagrin et sont dégradés par la pollution ou bouleversés par le réchauffement climatique. Voilà où nous en sommes. Les idéologies du mépris des animaux sont sérieusement fragilisées. Les pratiques qu’elles servaient à justifier poursuivent globalement leur expansion, bien qu’étant dès à présent freinées ou stoppées ici ou là. L’étape où l’évolution des mentalités se traduit en inversion de cette marche vers le pire reste encore à franchir.
Le philosophe Peter Singer estime que l’abolition de l’exploitation animale relève d’un « processus d’évolution morale », d’un « aboutissement », d’une « étape ». Partagez-vous cette conception graduée, progressiste et presque mécanique ?
« Le rapport de force leur est devenu si défavorable que la fin de l’exploitation animale n’est concevable que si la main qui les écrase relâche son emprise. »
On ne s’engage pas pour une cause si on n’a aucun espoir d’aboutir. Il y a en effet derrière le mouvement pour l’abolition de l’exploitation animale l’hypothèse que cette évolution est, sinon mécaniquement assurée, du moins envisageable. Cet espoir est alimenté par le fait que des évolutions passées ont déjà montré qu’il n’était pas totalement vain d’espérer le dépassement du chauvinisme qui porte à réserver sa sollicitude, sa solidarité, ou son souci de ne pas nuire, aux membres de son propre groupe. Si l’on est capable de questionner ou combattre la tendance à privilégier indûment les membres de son clan, ethnie ou nation, quoi qu’il en coûte aux étrangers, on doit être capable de remettre en cause les privilèges injustement acquis au détriment des individus appartenant à d’autres espèces. Cette conception rejoint effectivement des idées exprimées par Peter Singer dans The Expanding Circle. Parmi les facteurs portant à l’optimisme, on peut citer la thèse avancée par Steven Pinker dans The Better Angels of Our Nature, selon laquelle les données disponibles attestent d’une réduction de la violence au fil des siècles ou millénaires, qu’il s’agisse des guerres, des homicides, de la violence envers les femmes, les homosexuels ou les enfants. (Pinker traite de la violence intra-humaine, même s’il mentionne, parmi les évolutions relativement récentes à l’échelle historique, les « révolutions des droits » — parmi lesquelles la montée de revendications sur les droits des animaux).
On peut comprendre aussi l’intérêt que portent des antispécistes aux thèses, observations, expériences historiques, qui suggèrent l’existence d’un altruisme vrai : la possibilité d’une pensée et d’une action dont le bénéficiaire n’est ni sa propre personne, ni un soi élargi à ceux qui partagent les mêmes gènes, les mêmes difficultés ou les mêmes privilèges que soi. À cet égard, on ne devrait pas retrouver chez les antispécistes l’attachement que manifestent certains militants de causes humaines à l’idée que « la lutte contre l’oppression doit être l’œuvre des opprimés eux-mêmes », comme si les seules luttes de libération dignes et authentiques étaient celles passant uniquement par cette voie — ceci portant parfois à réécrire l’histoire de progrès accomplis de façon à gommer le rôle, pourtant bien réel, joué par des acteurs ou facteurs extérieurs. Les animaux ne se libéreront pas sans l’appui d’alliés humains. Non qu’ils soient incapables de résistance : il existe une foule d’actes de résistance animale, comme l’ont souligné Jason Hribal et d’autres. Non qu’ils soient « sans voix » : ils expriment de façon parfaitement intelligible qu’ils ne sont pas volontaires pour être saignés, chassés, piégés, emprisonnés ou soumis à des expériences douloureuses. La connaissance de la façon dont ils souhaitent vivre n’est pas hors de portée. Être leur allié n’est pas se substituer à eux pour en dessiner les contours. Mais le rapport de force leur est devenu si défavorable que la fin de l’exploitation animale n’est concevable que si la main qui les écrase relâche son emprise. D’où, effectivement, l’importance de pouvoir compter sur une évolution morale et sur un altruisme qui ne s’arrête pas aux membres de sa chapelle. Rien d’étonnant, par exemple, à ce que Matthieu Ricard, auteur de Plaidoyer pour les animaux, ait également rédigé un volumineux Plaidoyer pour l’altruisme.
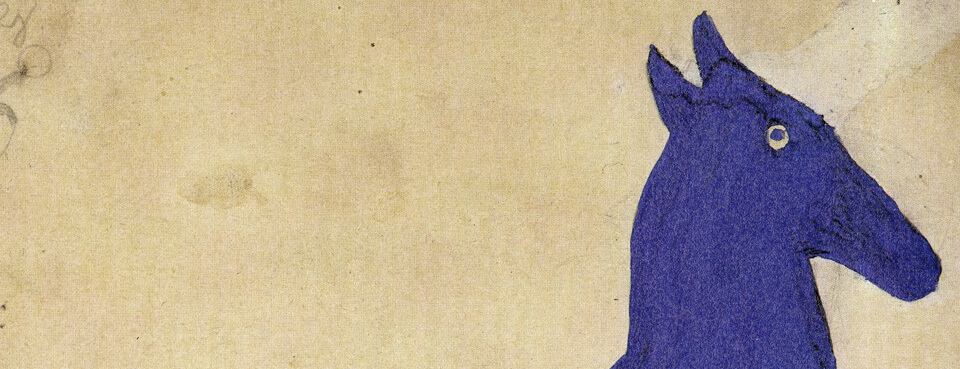
(Par Bill Traylor)
La France, estime aussi Peter Singer, est une exception occidentale en la matière : pourquoi ce pays se crispe-t-il davantage que les autres ?
Peut-être Peter Singer a‑t-il un peu changé d’avis sur ce point. Dans la conférence qu’il a donnée à Paris le 30 mai 2015, il a fait état du contraste entre l’incompréhension qu’il rencontrait quand il se rendait en France dans les années 1970, et les progrès observés au cours de ses visites ultérieures, dont témoignait le public nombreux venu l’écouter en cette occasion. Il est néanmoins certain que ce pays n’a pas été précurseur, loin de là, que ce soit dans le développement de l’éthique animale contemporaine, dans celui d’un mouvement des droits des animaux, ou dans l’intégration dans la législation de quelques dispositions protectrices des animaux dits de rente. Cela tient-il à une mentalité proprement française ? À cet égard, il est devenu rituel d’évoquer l’influence de Descartes et de sa thèse des animaux-machines. Peut-être… mais Descartes eut une foule de contradicteurs en son temps et dans les siècles qui suivirent. Pourquoi, Descartes aurait-il plus fortement marqué nos concitoyens que, par exemple, Montaigne ou Voltaire ; et, d’abord, combien d’entre eux ont été lire ces auteurs ?
« Pour faire reculer l’exploitation animale, il n’est pas nécessaire de sacrifier l’attachement aux plaisirs de la table. »
En matière de philosophie, un facteur a sans doute davantage pesé sur le retard français que l’héritage cartésien. On distingue en général deux manières de faire de la philosophie aujourd’hui : la tradition « continentale », très présente en France, et la tradition « analytique », très présente dans le monde anglo-saxon et dans laquelle l’antispécisme est né. Ces deux courants communiquent peu ; il n’est donc pas étonnant que les ouvrages fondateurs de l’antispécisme aient tardé à être lus et traduits par les intellectuels et les éditeurs français. Au chapitre des mentalités, il est arrivé à Peter Singer de mentionner l’attachement particulier que manifestent les Français à la gastronomie — au point que certains semblent ressentir les critiques adressées à leur façon de s’alimenter comme une atteinte à l’honneur national. Il est probablement vrai que les Français sont parmi les champions du temps passé à parler ou écrire sur la bouffe. Dans le sport universel consistant à s’enorgueillir de faire mieux que les Padchénous, les Français citent volontiers l’excellence de leur art culinaire. Dans les faits, il est douteux que chacun d’eux soit un cordon bleu et un fin gourmet. Les surgelés, conserves et autres plats préparés se vendent bien. Les fast-food ne manquent pas de clients. Selon un sondage, les Français passeraient moins de temps que les Britanniques à cuisiner. Peu importe, au fond. Car pour faire reculer l’exploitation animale, il n’est pas nécessaire de sacrifier l’attachement aux plaisirs de la table, qu’il repose ou non sur une réelle expertise gustative et culinaire. Ce qui va arriver, ce qui est en cours, c’est la perte de vitesse de l’association mentale entre alimentation non carnée et nourriture triste et fade. La cuisine végane passe par les étapes qui la normalisent et lui donnent ses lettres de noblesse selon les canons du genre : enrichissement et meilleure visibilité de la gastronomie végane notamment via des blogueurs et surtout blogueuses de talent ; événements tels que les concours de cuisine et pâtisserie ; édition de livres de cuisine ; mise en avant de tel chef étoilé qui met la cuisine végétale à l’honneur. Petit à petit, la curiosité, parfois la sympathie, prennent le dessus sur la prévention.
On ne compte plus les reportages où un journaliste suit une famille végane : les courses, les préparatifs, la dégustation du repas. La presse féminine s’est mise elle aussi à publier des articles sur le véganisme et à les assortir de recettes. L’attachement à la tradition culinaire ne sera sans doute pas un obstacle plus sérieux en France que dans d’autres pays. On ne mange pas comme il y a cent ans, et dans un siècle les usages auront à nouveau été bouleversés. Le tout s’est fait, et se fera, sur le fond du bavardage familier mêlant odes aux traditions ancestrales et célébration des innovations culinaires. Côté mentalités, on pourrait se demander aussi s’il y aurait une indifférence plus marquée des Français au sort des bêtes que dans les pays similaires. Mais là encore, rien de décisif ne vient confirmer cette hypothèse. On pourrait multiplier les exemples de sondages où une majorité de personnes déclarent accorder de l’importance au bien-être animal. Selon un eurobaromètre de 2005, il y a onze ans, la France était déjà dans la moyenne de l’UE à 25 à cet égard. Selon un eurobaromètre publié en 2016, 83 % des répondants français se déclaraient favorables à une meilleure protection des animaux d’élevage (la moyenne étant de 82 % pour l’ensemble des personnes de l’UE à 28 ayant répondu au questionnaire). Tout compte fait, il n’est pas certain qu’il y ait dans la société française des facteurs la conduisant à se crisper davantage et plus durablement que d’autres face à l’exigence de justice pour les animaux. Aujourd’hui, les obstacles sont plutôt d’ordre institutionnel.
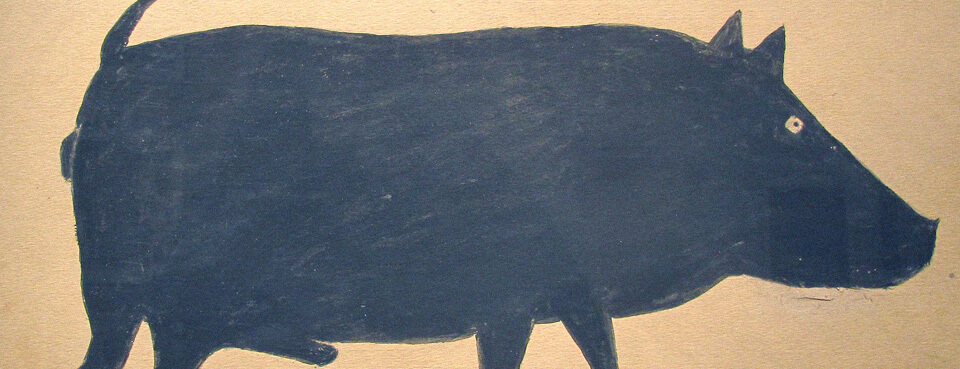
(Par Bill Traylor)
Du primaire au supérieur, l’enseignement fait très peu de place à l’acquisition des connaissances qui amènent à percevoir les animaux comme nos prochains, tandis qu’il véhicule encore largement les idées et pratiques incitant à les mépriser ou à les réifier. On peut visionner sur ce sujet la vidéo de la conférence donnée par Dominique Droz, en janvier 2016, à la Cité des sciences dans le cadre du cycle « Révolutions animales ». Une particularité française est l’enseignement de philosophie en terminale. On y aborde un certain nombre de notions par le biais de ce qu’en ont dit les grands auteurs plutôt que par les travaux les plus récents en philosophie ou en science (car un certain nombre de notions abordées en classe de philosophie relèvent aujourd’hui des sciences : la conscience, la pensée, le langage, la mémoire…). Il en résulte qu’on pose les problèmes en termes binaires périmés (inné/acquis, nature/culture, intelligence/instinct…), que sont présentées comme valables (parce que défendues par de grands philosophes) des théories fausses, et qu’on invite les élèves à se faire une opinion sur des questions depuis longtemps résolues. Par exemple, la question de la possibilité d’une pensée sans langage est encore trop souvent abordée par le biais des débats entre philosophes des siècles passés plutôt que par ce qu’en disent les psychologues et les éthologues aujourd’hui. Enfin, il est encore fréquent que les animaux non-humains ne soient évoqués que pour mettre en lumière des différences (réelles ou supposées) avec les humains (les fameux « propres de l’homme »), jamais des points communs ou une continuité. Cet enseignement contribue de la sorte à perpétuer le mythe du gouffre infranchissable entre humains et animaux. En matière de psychologie, l’hégémonie de la psychanalyse en France, des années 1970 jusqu’à la fin du XXe siècle, a aussi contribué à l’idée d’une différence de nature entre la psychologie humaine, faite d’une tripartition entre le « ça » (les pulsions), le « moi » (la pensée conscience découlant du langage) et le « surmoi » (les valeurs morales), et la psychologie animale uniquement constituée du « ça » (les pulsions, l’instinct).
« La France est à l’échelle européenne une grande puissance de l’exploitation animale. Dans l’UE, elle se situe au 4e rang pour les prises de pêches et au 2e rang pour la production aquacole. »
Une réglementation en place depuis 2011 impose la présence de produits animaux dans tout repas servi dans la restauration scolaire. En leur état actuel, les recommandations nutritionnelles du PNNS, le Programme national nutrition santé, font office d’arme de guerre contre le végétalisme. La seule chose qui en soit dite est que ce régime est dangereux et à proscrire absolument, là où d’autres pays donnent aux végétaliens et végétariens des conseils pour avoir un régime équilibré. (Il y a quelque espoir cependant que la nouvelle version du PNNS, qui sera mise en place fin 2016, soit moins caricaturale.) La France est à l’échelle européenne une grande puissance de l’exploitation animale. Dans l’UE, elle se situe au 4e rang pour les prises de pêches et au 2e rang pour la production aquacole. Elles détient le plus grand cheptel bovin de l’Union, se situe au premier rang pour la production d’œufs, au 2e pour la production de volailles et au 3e pour celle de cochons. Le ministère de l’Agriculture se comporte autant que faire se peut en courroie de transmission des attentes des filières de productions animales. On peut documenter l’attitude récurrente de la part de l’exécutif (par-delà les changements de majorité) de complicité active pour éviter l’application des mesures, pourtant modestes, de protection des animaux d’élevage liées à la réglementation européenne. En amont, le gouvernement français joue généralement le rôle de frein dans l’élaboration de directives européennes de bien-être animal, de même que dans les négociations portant sur les limites fixées à la pêche. Les chasseurs et acteurs des filières viande ont de longue date mis en place des méthodes de lobbying efficaces auprès des parlementaires, qui sont nombreux à émarger au « Club des amis du cochon », « Observatoire de l’œuf » et autres clubs « Vive le foie gras ».
En résumé, notre analyse est qu’il n’y a pas vraiment lieu de s’inquiéter de l’existence de freins (plus grands qu’ailleurs) à l’évolution vers l’abolition de l’exploitation animale qui tiendraient à quelque particularité du caractère national. Mais en France, les organisations tournées vers les animaux destinés à la consommation se sont développées tardivement (à l’exception de l’OABA). Le mouvement de libération animale français ne compte pas non plus parmi les premiers à avoir vu le jour. Outre sa petite taille initiale, il s’est surtout soucié au départ de forger des arguments. Dans un second temps, il s’est agrandi, diversifié, a élargi ses modes d’action, et a appris à mieux s’y prendre pour toucher le public et les médias. Il est ainsi devenu visible pour la population, condition sine qua non pour le débat sur la place faite aux animaux se voit reconnaître le rang de « question de société ». Mais il est resté sans prise sur les partis et décideurs politiques. Une troisième phase s’est ouverte où il cherche à peser davantage à ce niveau avec quelques réalisations dans ce sens (par exemple, l’observatoire Politique et animaux), et avec l’appui de quelques élus qui agissent honnêtement et avec détermination pour améliorer la condition animale. Cependant, pour l’heure, la capacité du mouvement animaliste à peser sur la sphère politique reste très mince comparée à celle des industries d’exploitation animale.

(Par Bill Traylor)
Vous avez plus d’une fois tenu à vous placer du côté de la raison, et non de la pitié, de l’empathie ou de l’amour : en quoi l’analyse rationnelle est-elle plus pertinente que les affects, pour libérer les animaux non-humains ?
Les fondateurs des Cahiers étaient dans un contexte où la préoccupation pour les animaux était facilement raillée comme relevant d’un sentimentalisme niais, décrite comme une sorte de maladie affectant les esprits faibles et émotifs, tandis que les personnes sensées savaient se concentrer sur les « vrais problèmes » (comprendre : exclusivement ceux affectant des humains). Dans un tel contexte, il était essentiel de faire entendre que c’était via une argumentation solide que les antispécistes revendiquaient une prise en compte équitable des intérêts des animaux. Montrer que la discussion était menée aussi rigoureusement que sur d’autres sujets d’éthique appliquée, c’était faire changer de camp la charge de sentimentalisme et d’irrationalité. On sait par ailleurs que les systèmes violents sécrètent l’idéologie qui rend cette violence invisible ou la justifient comme nécessaire ou inévitable. On sait aussi que ce qui est usuel dans le lieu et temps où on vit nous paraît facilement normal. Il n’y a pas matière à s’en désoler dans l’absolu : nous serions incapables de nous repérer dans la société et de nous y intégrer si nous n’avions pas cette faculté d’absorber les codes, croyances et pratiques du milieu où nous sommes immergés. Mais sans une capacité à prendre du recul, à questionner parfois ce qui semble de l’ordre de l’évidence, on ne parviendrait jamais à venir à bout des injustices, ou autres sources de malheurs évitables, solidement ancrées dans l’ordre établi.
« Les systèmes violents sécrètent l’idéologie qui rend cette violence invisible ou la justifient comme nécessaire ou inévitable. »
Rien d’étonnant alors à ce que tant Singer que les fondateurs des Cahiers aient été surtout sensibles au fait que le conformisme laisse intacts des préjugés aux effets délétères. Ils ont cherché à établir un état des lieux non biaisé de ce que subissent les animaux, pour qu’il se substitue à des faits ignorés, ou confortablement oubliés, ou rapportés de façon enjolivée. Ils ont voulu montrer l’inconsistance des raisons avancées pour se désintéresser des bêtes. Ils ont misé sur le fait que la réflexion permettrait de prendre conscience que ce qui est fait aux animaux ne peut être justifié selon des principes moraux d’équité communément admis, et cela quand bien même les destinataires de leur appel se trouvent en position de groupe exploiteur. Cela suppose que la raison, entendue à la fois comme capacité à distinguer le vrai du faux, et comme aptitude à peser avec impartialité les intérêts en présence, ait une certaine force opérante. La réticence à se fier beaucoup à l’empathie, l’amour, la compassion… pour établir la justice tient aussi au fait bien connu que la sympathie est partiale. Nous sommes plus émus par ce qui arrive à ceux qui nous sont proches (géographiquement, socialement, physiquement, culturellement…) qu’à ceux qui nous sont lointains. C’est ce qu’illustre l’expérience de pensée désormais canonique de Singer à propos de l’enfant en danger de mort. En voyant de ses yeux un enfant sur le point de se noyer dans un étang, personne n’hésiterait à plonger pour le sauver, quitte à ruiner une paire de chaussures neuves. Mais peu se sentent tenus de donner à une association humanitaire (un montant égal au prix de ces mêmes chaussures par exemple) bien que cela puisse sauver la vie à un enfant dans un pays pauvre. On aime les chiens qui partagent notre vie, mais on dévore tranquillement les cochons qu’on ne fréquente pas. Loin des yeux, loin du cœur. C’est ce même constat qui conduit Tom Regan à récuser la prétention parfois affichée de l’éthique du care à constituer une alternative aux éthiques classiques. Sur le versant utilitariste, comme sur le versant de la théorie des droits, les philosophes les plus marquants de l’éthique animale contemporaine considèrent qu’un principe d’impartialité ou d’universalité constitue un pilier central d’une théorie éthique digne de ce nom.
C’est une chose de faire appel à la raison pour corriger l’erreur de perspective qui résulte de la proximité ou de l’éloignement d’autres êtres par rapport à nous, ou pour mettre en miettes des idéologies oppressives et meurtrières. C’en est une autre d’en arriver à voir la pitié, la charité, comme de regrettables obstacles à l’action juste, ou encore de n’afficher que mépris pour l’application routinière des normes sociales, et pour le sentiment de bien faire qu’on peut éprouver en s’y conformant. La survalorisation du cogito finit alors par « sonner un petit peu creux : comme le petit pois qui danse dans sa cosse desséchée1 ». Car il se pourrait bien que l’empathie, la compassion, soient la matière première essentielle de la morale. C’est par elles que nous établissons la connexion avec les sentiments des autres, et que nous sommes affectés dans le même sens qu’eux par ce qui leur arrive de bien ou de mal, même si le reflet dans notre esprit n’est certes pas l’image exacte de ce qui survient dans le leur. Les animaux sociaux, humains ou non, ont par ailleurs la faculté d’apprendre des normes de vie en société, et d’acquérir des formes d’auto-contrôle du comportement qui rendent possible le vivre ensemble. Ils le font avec des congénères mais aussi avec des individus d’autres espèces. Y compris chez les humains, l’essentiel des décisions et interactions avec les autres reposent une perception intuitive de ce qui est approprié, sur un sentiment immédiat qui désigne une attitude comme la bonne, et non sur l’application consciente d’une règle de conduite. On est même souvent incapable d’expliciter le principe qui fonde nos jugements et décisions. La délibération morale est un processus mental lent et difficile. Il ne peut certainement pas se substituer à toutes les autres voies par lesquelles nous apprécions les situations et dirigeons nos actions.

(Par Bill Traylor)
Dans un entretien paru dans le numéro 2 de Versus Magazine, David Olivier déclarait en réponse à une question sur l’origine des Cahiers antispécistes : « L’accent sur la rationalité éthique était crucial dans le contexte de l’époque. […] Cependant, l’insistance sur notre rationalité revenait paradoxalement aussi à renier notre ressemblance avec les êtres que nous défendions, et ainsi à traduire et à perpétuer un spécisme intériorisé. » La focalisation sur la (seule) rationalité a d’autres effets indésirables. Elle met en position de contributeurs privilégiés à la libération animale ceux parmi les humains qui ont une facilité à verbaliser et à jongler avec la logique et les concepts abstraits, au risque de toucher surtout les humains qui ont des facilités du même ordre, alors que d’autres talents sont également précieux pour développer la solidarité animale et dégager toutes les voies lui permettant de s’épanouir. L’accent mis sur la rationalité éthique laisse sur la touche les premiers concernés. Des formes d’altruisme et de sens de l’équité existent bien chez des animaux. Néanmoins, les bêtes ne sauraient jouer aucun rôle dans la libération animale si le jeu consistait uniquement à discourir sur le bien et le mal, ou sur la non-pertinence éthique de la frontière d’espèce. Ils ont heureusement d’autres moyens de participer, d’attirer sur eux l’intérêt ou la bienveillance, et de proposer d’établir des relations plus équitables. L’émerveillement qu’ils inspirent en est un. Françoise Armengaud écrit : « Dans l’émerveillement se concentre et s’illumine pour moi la quintessence de ce que je ressens à l’égard des animaux, à l’égard des bêtes. Si je prends l’émerveillement comme guide et fil conducteur, c’est afin de remercier les animaux, les bêtes, pour leur beauté, leur grâce de bien vouloir exister, en dépit de la traque qui leur est menée, pour la joie que leur présence me procure — bien que cette joie soit en permanence endeuillée par le savoir du sort qui leur est trop souvent réservé2. »
« La question devient de comprendre quels sont les facteurs qui, dans un système spéciste, bloquent les affects qui portent à épargner les animaux. »
L’émerveillement peut naître de la simple contemplation. Mais avec une partie des bêtes, notamment les animaux terrestres domestiqués de longue date, il y a plus. Ils savent communiquer avec les humains et établir des relations de confiance avec eux. L’apprivoisement mutuel peut être source de joie et d’expériences inédites de part et d’autre. Il n’est pas difficile de lire les signaux de terreur, bien-être, invitation à faire ceci ou cela qu’ils émettent. Dès lors, la question devient de comprendre quels sont les facteurs qui, dans un système spéciste, bloquent les affects qui portent à épargner les animaux. C’est la question que soulève Mélanie Joy (ici et là) et plus généralement tous ceux qui cherchent à percer le mystère du paradoxe de la viande. Quand on regarde les messages émis par les associations animalistes, on voit qu’une part non-négligeable consiste à rendre présents les animaux, physiquement ou par l’image, à leur restituer le pouvoir qu’ils ont d’être compris, de manifester leur volonté, d’émouvoir, de nous rendre attentifs à ce qui les affecte. C’est vrai des vidéos et photos qui les montrent dans les situations atroces d’abattage, d’enfermement perpétuel, de transport dans de mauvaises conditions, d’exposition à des expériences douloureuses. Mais il n’y a pas que cela. Il y a les refuges pour qui mettent le public en contact avec des animaux heureux rescapés des élevages, les chaînes de solidarité pour adopter des poules destinées à l’abattoir, les images montrant les liens sociaux ou parentaux qu’établissent les animaux quand ils peuvent agir à leur guise, ou encore le travail accompli pour diffuser les connaissances en éthologie sur l’intelligence et la vie émotionnelle des animaux.
Au total, il est vrai que les Cahiers antispécistes ont fait une large place à l’argumentation éthique. Il est exact qu’on peut relever dans certains écrits des fondateurs des passages indiquant une conviction que la raison est plus efficace que l’émotion pour aller vers la libération animale. En revanche, on ne peut pas dire du mouvement animaliste dans son ensemble qu’il juge l’analyse rationnelle plus pertinente que les affects pour libérer les animaux, ni qu’il s’occupe d’arbitrer un match entre le cœur et la raison pour déclarer l’un des deux vainqueurs. Il use de tous les leviers à sa disposition. Pour en revenir aux Cahiers, il n’y a pas de politique de la rédaction visant à écarter les auteurs qui font grand cas de la portée potentielle de l’empathie, à la manière de Brian Luke qui estime que « la disposition à se soucier des animaux n’est pas la lubie d’un petit nombre, sur laquelle on ne saurait compter, mais, plutôt, l’état normal des humains en général » et que par conséquent « l’exploitation des animaux prospère, non parce que les gens s’en moquent, mais en dépit du fait qu’ils ne s’en moquent pas ». Les approches tournées vers la recherche des facteurs qui étouffent la sympathie envers les animaux, et ce faisant permettent le crime, sont des contributions précieuses qu’il aurait été absurde de dédaigner. De même, les Cahiers ont estimé faire œuvre utile en publiant les réflexions de Martin Balluch dont la prémisse est que « les humains sont bien davantage des animaux sociaux que des animaux rationnels », qui en déduit qu’on ne parviendra pas à faire reculer le spécisme si le recours à l’argumentation rationnelle est le seul moyen utilisé pour y parvenir, et conclut qu’il est essentiel d’avoir cela à l’esprit pour élaborer des stratégies efficaces.
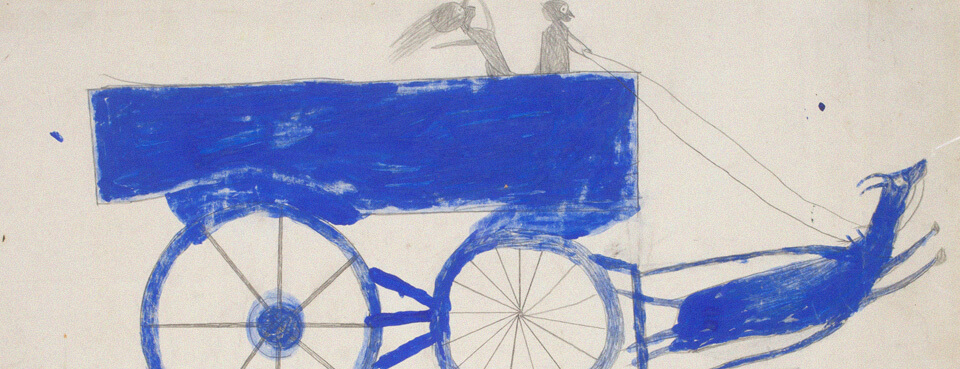
(Par Bill Traylor)
Pourquoi tenez-vous volontiers à dissocier la lutte écologique, ou « naturaliste », de la cause animale ?
Commençons par la nature, nous reviendrons ensuite sur la lutte écologique. Ce dont les Cahiers se sont toujours dissociés, c’est de l’invocation de la nature, ou du respect de la nature, comme critère de ce qu’il est bon ou juste de faire. Une telle prescription ne peut pas faire office de critère éthique. La nature, comme l’écrivait John Stuart Mill il y a plus d’un siècle et demi3, c’est un nom pour désigner soit tout ce qui existe et ses propriétés, soit tout ce qui existe en l’absence d’intervention humaine. Dans le premier sens, quoi que fassent les humains, ils respectent la nature, dans le second, quoi qu’ils fassent, ils la violent. Sur quoi repose alors le tour de passe-passe qui nous fait croire que l’injonction d’obéir à la nature pourrait nous servir de guide ? Il consiste parfois à sélectionner des portions spécifiques de l’existant (décrites de façon adéquate ou non), puis à passer sans autre forme de procès du constat de ce qui est à une affirmation sur ce qui doit être. C’est ainsi que l’on a pu sauter allègrement de « les hommes ont toujours exercé leur autorité sur les femmes » à « il est naturel (c’est-à-dire normal, souhaitable) que les femmes soient soumises aux hommes ». Ou encore que l’on passe de « les humains ont toujours mangé de la viande » à « les humains doivent manger de la viande ». Ce saut périlleux du descriptif au prescriptif n’est pas totalement inconscient. Si ses auteurs croyaient avoir affaire à un déterminisme incontournable, ils n’éprouveraient pas le besoin de prescrire : nul ne juge nécessaire de préconiser de se diriger vers le sol quand on saute en parachute.
« Il y a de bonnes raisons de se montrer suspicieux envers les injonctions morales étayées par un appel à respecter l’ordre naturel. »
Ce ne sont pas non plus tous les faits présents de longue date qui sont élevés au rang de loi morale. Il est assez rare que les constats « il y a toujours eu des guerres » ou « il y a toujours eu des épidémies » soient vus comme des motifs valables pour favoriser les conflits armés ou répandre des maladies contagieuses. D’autres appels à obéir à la nature ne doivent rien à une observation d’invariants, réels ou supposés ; ils semblent plutôt renvoyer à une personnification de la Nature, qui à la manière d’une divinité édicterait une loi morale dont certains de ses sujets seraient coupables de s’écarter. Des jugements tels que « l’homosexualité est contre-nature » sont proférés, alors même que l’on sait pertinemment qu’en tout temps et lieux, il y a eu des pratiques homosexuelles dans les sociétés humaines — et qu’elles existent chez de nombreuses espèces animales. On peut enfin relever qu’il ne fait pas bon, souvent, se retrouver classé du côté des êtres de nature (englués dans leurs déterminations naturelles et n’exprimant que ce pour quoi la nature les a programmés), par opposition aux êtres de liberté (capables de s’arracher à la nature par la volonté, la raison, la culture, la civilisation…). C’est, ou ce fut, le cas des animaux, mais aussi des femmes, vues comme régies par l’instinct, ou encore celui des sauvages.
Il y a donc de bonnes raisons de se montrer suspicieux envers les injonctions morales étayées par un appel à respecter l’ordre naturel. Cette conclusion ne doit pas être confondue avec une autre qui, elle, est aberrante : celle qui consisterait à dire que « la nature n’existe pas », qu’elle est une « page blanche », et, par conséquent, à vivre dans l’illusion que le réel est infiniment malléable, de sorte que tout état du monde considéré comme désirable serait accessible. On a besoin de comprendre le mieux possible ce qui explique des phénomènes physiques ou des comportements individuels ou collectifs, sans quoi on s’expose à bâtir des idéaux vains ou dangereux. En résumé, le précepte « obéir à la nature » est creux, tandis que le précepte « connaître la nature » est d’une grande sagesse, sans toutefois suffire à fonder une éthique à lui seul. Il faut garder les deux aspects à l’esprit quand on cherche à bâtir un monde où il fera meilleur vivre.

(Par Bill Traylor)
Un autre aspect relatif à la nature mérite d’être souligné. Chez beaucoup de penseurs de l’éthique animale, on trouve un rejet très explicite des visions idéalisées de la nature qui la décrivent comme bonne ou harmonieuse. On parle ici de la nature au sens de ce qui existe indépendamment de l’intervention humaine. Cette nature n’est ni bonne ni juste : les animaux sauvages sont confrontés à des événements dramatiques qui causent d’immenses souffrances et d’innombrables morts prématurées : la faim, la soif, le froid, la prédation, la maladie, la violence exercée par des congénères… Un premier effet de ce constat est de nous prémunir contre le penchant à la misanthropie, ou à une sorte de spécisme inversé, qui s’exprime parfois chez des personnes conscientes des torts considérables causés par les humains aux autres animaux. Non, tout le mal ne vient pas des humains, loin de là. Non, avant l’Anthropocène, la Terre n’était pas un paradis. Un second effet est de conduire à se demander si nous avons, ou pas, un devoir et un pouvoir de remédier aux maux d’origine non-humaine qui frappent les animaux. Le problème tient en une ligne mais tenter de le résoudre mène à des interrogations vertigineuses. Les Cahiers ont publié plusieurs textes de David Olivier et Yves Bonnardel, ainsi qu’un texte de Steve Sapontzis qui sont dans l’optique d’un devoir d’intervention. Ils ont aussi rendu compte de la position de Sue Donaldson et Will Kymlycka, qui sont plus proches de l’optique de Tom Regan consistant à considérer les animaux sauvages comme des nations étrangères, dans l’existence desquelles on ne doit pas s’immiscer (sauf assistance ponctuelle). Cette question de la souffrance des animaux sauvages fait l’objet de travaux plus nombreux depuis quelques années. C’est sans doute un domaine où il faut s’attendre à voir la production intellectuelle s’intensifier encore. Pour le moment, cela n’a pas de retombées significatives sur les objectifs poursuivis par le mouvement militant.
« On n’a aucune honte à préconiser la pêche durable, ce qui revient à compter pour rien la terreur et la lente agonie infligées à ses victimes. »
Venons-en aux luttes écologiques ou aux politiques publiques à vocation écologique. Nous ne tenons pas à nous en dissocier à tout prix. Ce qui pose problème, c’est l’asymétrie avec laquelle ces questions sont traitées, selon qu’il s’agisse d’humains ou d’autres animaux. Les humains sont pris en considération en tant qu’individus. Les autres animaux sont le plus souvent immergés dans des ensembles plus vastes, et c’est à ces ensembles qu’on accorde de la valeur, qu’il s’agisse des espèces ou des écosystèmes. De sorte qu’il semble que tout va bien tant que les espèces ne sont pas menacées et que les écosystèmes restent relativement stables. On n’a aucune honte à préconiser la pêche durable, ce qui revient à compter pour rien la terreur et la lente agonie infligées à ses victimes. C’est comme si on approuvait le massacre perpétré sur une population humaine du moment que le prélèvement démographique peut être comblé par la reproduction des survivants. Or, chez les animaux, humains ou non, ce sont les individus, et eux seuls, qui sont dotés d’une subjectivité qui fait que la façon dont se déroule leur existence leur importe. Les antispécistes ne sont pas en guerre contre l’écologie politique. Ils voudraient que la préoccupation légitime et nécessaire d’assurer un environnement vivable aux habitants présents et futurs de la planète intègre pleinement que ces habitants sont tous les être sentients, et non pas les seuls humains.
La philosophe Élisabeth de Fontenay refuse la notion de spécisme au nom, notamment, du « devenir singulier » des hommes et de leur capacité à produire du discours. L’analogie entre spécisme, racisme et sexisme la « choque », déclare-t-elle. Ce qui ne l’empêche pas de prendre, depuis nombre d’années, la défense des animaux. On pourrait donc refuser l’alternative spécisme/antispécisme et vouloir tout de même garantir aux animaux leur dignité ?
Avant d’aborder la position d’Élisabeth de Fontenay, nous allons dire quelques mots sur les mérites et limites de la notion de spécisme, tels que nous les percevons. Cette notion, qui fut forgée sur le modèle des mots « racisme » ou « sexisme », est une entrée utile pour défendre les animaux face aux nombreuses expressions du narcissisme humain, et de la dévalorisation corrélative des bêtes. Néanmoins, ce n’est ni un passage obligé, ni un concept suffisant. Emprunter ce chemin conduit à passer par une démarche comparative, à s’appuyer sur des valeurs supposées déjà acquises, et à insister sur la notion de discrimination arbitraire. Quand on aborde la question sous cet angle, on cherche à sensibiliser un interlocuteur qui est déjà acquis à l’idée que d’autres formes de discrimination et exploitation sont des maux, mais qui ne l’admet pas encore pour les animaux. Si des délimitations par des caractères biologiques tels que le sexe ou la couleur de peau ne sont pas pertinentes pour assigner des êtres à un destin funeste, lui demande-t-on alors, pourquoi l’appartenance d’espèce le serait-elle ? Comme, généralement, il répond que les hommes et les femmes, ou les Noirs et les Blancs, sont vraiment égaux, tandis que les animaux sont réellement moins intelligents que les humains, on évoque alors les « cas marginaux ». (L’expression « cas marginaux » désigne dans ce contexte les nombreux humains dont les facultés mentales sont inférieures à celles de certains animaux : nourrissons, personnes séniles, personnes atteintes de handicaps mentaux profonds.) Ceci met à nu le fait que c’est bien le critère « pur » d’appartenance d’espèce qui joue dans le sort peu enviable réservé aux animaux non humains.

(Par Bill Traylor)
Mais, là encore, l’argument ne peut fonctionner que face à un interlocuteur acquis à l’idée qu’il est criminel d’utiliser des personnes handicapées comme « cobayes » ou de consommer du rôti de nourrisson humain. La démarche comparative à laquelle conduit l’approche via la notion de spécisme se manifeste aussi par le fait que, systématiquement, on va souligner que telle attitude, que tout le monde juge hideuse envers des humains, et qui est sévèrement punie par la loi, est monnaie courante envers les animaux. Ceci a parfois pour effet chez l’interlocuteur de faciliter le réflexe de « se mettre à la place » des animaux et ainsi de l’aider à réaliser que ce qui leur arrive est horrible. L’approche comparative porte par ailleurs à mettre en lumière ce qu’il y a d’analogue entre des formes d’oppression frappant des groupes très différents. Florence Burgat emploie parfois à ce propos le terme « animalisation » (animalisation de groupes humains et animalisation des animaux) : un processus qui consiste à rabaisser, à penser un groupe comme vil, et par là à le rendre disponible, à en faire des êtres dont on peut disposer à sa guise. Creuser ce qu’il y a de commun entre les diverses formes d’animalisation peut être riche d’enseignements.
« Le détour par la voie comparative a le mérite de faire réagir via le sentiment d’injustice. »
Reste qu’aborder la question animale par l’intermédiaire de références à d’autres formes d’injustice constitue un détour. Quand bien même le racisme et le sexisme n’auraient jamais existé, quand bien même les Homo sapiens auraient été une espèce différente ne comportant aucun type de « cas marginaux », il resterait vrai que les animaux ne doivent pas être sacrifiés au bon plaisir des humains. À qui accède à la compréhension directe que la séparation forcée de la vache et du veau nouveau-né est un mal, et que cela ne saurait être justifié par l’objectif de s’approprier le lait de la mère, il n’est nul besoin de venir dire : « Attendez, je vais vous expliquer le spécisme, et en quoi il présente des similitudes avec le sexisme et le racisme. » Reste aussi que le seul élément rendu saillant par la notion de spécisme est l’existence d’une discrimination. Mais, évidemment, le tout n’est pas de mettre fin à l’inégalité. Si aux États-Unis la police se mettait à ouvrir le feu aussi facilement sur les Blancs qu’elle le fait sur les Noirs, on pourrait sans doute dire que la société est devenue moins raciste, certainement pas qu’elle est devenue meilleure. De même, rétablir l’égalité en utilisant autant de femmes à fournir du lait pour les veaux qu’on utilise de vaches pour fournir du lait aux humains ne serait pas une manière opportune de faire reculer le spécisme. Le détour par la voie comparative a le mérite de faire réagir via le sentiment d’injustice. Mais c’est la « voie directe » qui explicite en quoi la situation est un mal. Ce qui est fait à la vache et au veau est un mal à cause de la détresse occasionnée par la séparation, de l’existence grise que connaîtront l’un et l’autre, et de la vie dont on les privera en les envoyant à l’abattoir. C’est en cela que réside le mal, et non dans le fait qu’on n’inflige pas les mêmes préjudices aux femmes et enfants humains.
Concernant Élisabeth de Fontenay, non seulement l’entrée via la notion de spécisme n’est pas la voie qu’elle utilise, mais elle manifeste une allergie profonde pour ce concept. Quoi qu’on pense de sa position sur ce point, elle compte sans aucun doute parmi les intellectuels qui ont fait surgir la question de l’animalité dans l’espace académique et médiatique français, et parmi ceux qui pèsent en faveur d’une meilleure protection des animaux dans le droit. Elle se trouve dans le camp de ceux qui plaident pour des aménagements de l’élevage et de l’abattage, et non pas pour leur abolition. Elle a notamment préfacé un ouvrage dirigé par Jocelyne Porcher4, alors même que cette dernière s’illustre par une des formes les plus ahurissantes de défense de « la viande heureuse ». On peut néanmoins noter qu’à la différence de la plupart des tenants de la tuerie dans le « bien-être », Élisabeth de Fontenay n’a pas cherché à ajuster son discours à sa pratique personnelle de consommation d’animaux : « Il n’y a aucun fondement philosophique, métaphysique, juridique, au droit de tuer les animaux pour les manger, dit-elle. C’est un assassinat en bonne et due forme, puisque c’est un meurtre fait de sang-froid avec préméditation. »

(Par Bill Traylor)
L’opinion d’Élisabeth de Fontenay sur la notion de spécisme peut être vue comme relativement annexe par rapport à ce qui constitue le cœur de ses travaux. Elle-même dit ne pas travailler dans le domaine de la philosophie éthique, mais davantage dans celui de l’ontologie, avec par ailleurs un intérêt particulier pour le juridique. Son magnum opus (Le Silence des bêtes, paru en 1998) est un examen érudit de la tradition philosophique et théologique continentale sur le couple humanité/animalité, qui ne manque pas d’en souligner les errements. Il n’en reste pas moins qu’elle a exprimé avec constance, dans des écrits successifs et interventions orales, la répulsion que lui inspirent les analyses de Singer sur le spécisme, ou l’analogie entre racisme et spécisme ; elle a dit l’indignation que suscite chez elle la proposition d’étendre aux grands singes des droits humains fondamentaux5. Dans ses textes, nous percevons très distinctement combien elle est choquée, comme en témoigne l’accumulation de qualificatifs dépréciatifs à l’égard des pensées et penseurs incriminés. Mais soit nous n’avons pas compris, soit elle échoue à produire une argumentation qui se tienne. On trouve de façon répétée chez elle l’affirmation de sa défiance envers les « propres de l’homme », tant pour leur fonction d’exclusion des animaux que pour leur fonction d’exclusion des « cas marginaux » humains. Cependant, lorsqu’elle s’emploie à blâmer l’ignorance de la singularité humaine dont font preuve les auteurs qui dénoncent le spécisme, on voit revenir chez elle les propres de l’homme au galop : les humains produisent du droit, ont le langage articulé, endossent la responsabilité, possèdent le langage performatif (qui permet le prodige d’énoncés tels que : « La séance est ouverte. »). Élisabeth de Fontenay est soucieuse de tenir la biologie à distance de la philosophie. Ce qui importe, nous dit-elle, c’est que la singularité humaine a produit une histoire qui a conduit à se proclamer genre humain (lequel se superpose néanmoins exactement à la délimitation biologique de l’espèce).
« Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle se proclame spéciste ne nous empêche pas de reconnaître sa contribution à la défense des animaux. »
Mais pourquoi la même révérence n’est-elle pas due au moment du passé où l’histoire conduisit à diviser l’espèce entre civilisés et sauvages ? Pourquoi serait-il sacrilège que cette même histoire, poursuivant sa marche, élargisse le cercle au-delà des Homo sapiens ? Mystère. Et, bien sûr, surgit le hic des cas marginaux, des individus humains qui n’ont aucun des traits typiques de la « singularité ». La position d’Élisabeth de Fontenay semble être de dire (« semble », car encore une fois nous ne sommes pas sûrs de suivre) que la singularité humaine est une propriété non des individus mais de l’espèce et que c’est du fait de ce caractère collectif qu’elle donne une priorité à tout humain sur tout animal, indépendamment des traits individuels des uns et des autres. Peter Singer, dans un échange avec Élisabeth de Fontenay sur France Inter, a exprimé son franc désaccord avec l’idée de traiter les individus en fonction des propriétés de l’ensemble auquel on les rattache, illustrant son propos par l’exemple suivant. Imaginons qu’une femme vigoureuse postule à un emploi qu’elle est tout à fait capable d’occuper. Serait-il juste de lui refuser le poste au motif qu’il demande une grande force physique, qu’elle est femme, et qu’en général les femmes n’ont pas la force suffisante pour faire ce travail ?
Élisabeth de Fontenay conteste aussi le projet d’étendre les droits humains fondamentaux (à la vie, à la liberté, à ne pas être soumis à la torture) aux grands singes, au nom de l’offense, de la vexation, du scandale, que pareille chose représenterait pour le genre humain. Mais, dans le même temps, elle se dit tout à fait favorable à des droits protecteurs forts spécifiques aux singes. Qui sait si ces droits forts ne les protégeraient pas exactement des mêmes atteintes que ceux prévus dans le Great Ape Project ? Elle cite parmi les merveilles de la singularité humaine le fait qu’il ait pu se produire des événements tels que l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789, bien que cet épisode ait certainement été ressenti comme offensant par la noblesse, et qu’on eût pu éviter la dimension symbolique de l’affront en proclamant plutôt des droits spécifiques des seigneurs et des droits spécifiques des paysans, qui, habillage mis à part, auraient de fait mis les deux classes à égalité sur le plan légal. Il se peut que la raison profonde qui conduit Élisabeth de Fontenay à produire ces arguments peu intelligibles soit sa frayeur de voir revenir les temps où des humains décrétés moins humains que d’autres furent sacrifiés dans des conditions effroyables. Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle se proclame spéciste ne nous empêche pas de reconnaître sa contribution à la défense des animaux : par ses écrits, mais aussi par l’émission « Vivre avec les bêtes » qu’elle a animée pendant trois ans avec Allain Bougrain-Dubourg sur France Inter et qui a permis aux auditeurs de découvrir de multiples aspects et acteurs de la question animale.
Lire la seconde partie.
Toutes les illustrations sont l’œuvre de Bill Traylor (1853–1949).
- J. M. Coetzee met ces mots dans la bouche de son personnage Elisabeth Costello (Élisabeth Costello, Seuil, 2004, p. 107).[↩]
- Françoise Aremengaud, Apprendre à lire l’éternité dans l’œil des chats, Les Belles Lettres, 2016, p. 11.[↩]
- Dans son essai On Nature, qui ne fut publié après sa mort, en 1874.[↩]
- J. Porcher, Livre blanc pour une mort digne des animaux, Éditions du Palais, 2014.[↩]
- A notre connaissance, cette série d’écrits commence avec l’article qui paraît dans la revue Le Débat en mars-avril 2000, dans lequel elle commente le Great Ape Project.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Vincent Message : « Accomplir le projet inachevé des Lumières », juin 2016
☰ Lire notre entretien avec Renan Larue : « Boucheries et poissonneries disparaîtront progressivement », mars 2016
☰ Lire notre entretien avec Ronnie Lee : « Mettre un terme à l’exploitation animale », janvier 2016
☰ Lire notre entretien avec L214 : « Les animaux ? C’est une lutte politique », novembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Aurélien Barrau : « Le combat animalier est frère des combats d’émancipation et de libération », septembre 2015
☰ Lire notre entretien avec Normand Baillargeon : « Le statut moral des animaux est impossible à ignorer », septembre 2014


